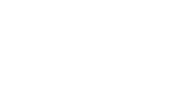L'âme et la cithare/25 - Notre richesse et nos talents servent à libérer ceux qui vivent dans la souffrance et le malheur.
par Luigino Bruni
Publié sur Avvenire le 20/09/2020
« Ce sont des "fils de la jeunesse" car celui qui était destiné à mourir entre vingt-cinq et trente ans devait se dépêcher d’engendrer. Un prix de consolation, celui de l’AT, du désert et des lances autour de la maison. Pour le philosophe, aujourd'hui comme hier, il n’y a rien que des clous dans la chair. »
Guido Ceronetti, Le Livre des Psaumes
Est-il possible d'associer Dieu à nos bénédictions et de le préserver des malédictions des autres ? Le remercier pour notre bonheur et ne pas le condamner pour notre malheur ?
La profusion est l'une des lois précieuses de la vie. Elle est tout à la fois la mère et la sœur de la générosité. On ne porte pas de fruits sans semer à la volée, sans qu’une bonne part de bon grain aille dans les épines, le long de la route et parmi les pierres, parce que si nous voulions semer uniquement dans ce que nous pensons être une bonne terre, rien de vraiment bon ne naîtrait. La bonne terre ne peut exister qu'entre les buissons et les rochers, et le geste énergique du semeur ne peut l’atteindre sans consentir à disperser, sans les compter, de nombreuses semences. Une communauté doit engendrer dix faux prophètes avant d’espérer en voir naître un vrai ; il faut former des milliers d’étudiants ordinaires pour en voir apparaître un excellent ; pour qu’advienne un acte d'amour agapè, nous devons attendre qu'il mûrisse au milieu de nos égoïsmes. Et une part de déperdition importante est nécessaire pour parvenir à un bon résultat. Toute avarice est stérile, toute magnanimité est féconde.
Mais la profusion la plus importante n'est pas celle qui sort de notre cœur, mais celle qui y entre : c'est celle que nous recevons et non celle que nous donnons, celle que nous voyons se répandre en nous et autour de nous, tel ce pain qui nous nourrit et nourrit nos amis "pendant notre sommeil". Il arrive un jour où nous comprenons enfin que les bénédictions qui ont accompagné notre vie ne sont pas le fruit de notre engagement, mais seulement et entièrement des dons, des grâces, uniquement et toujours providentielles. Notre intelligence, nos talents prometteurs, notre vie de couple, nos enfants, nos amis, notre communauté, notre santé, le sens et la joie de la vie intérieure, s’émouvoir à la lecture d’un poème ... sont autant de réalités qui ne sont pas entrées dans notre vie en raison de nos mérites : elles nous ont simplement trouvés dans le sillage d'une mystérieuse liberté amoureuse. Être une "bonne terre" ne relève pas notre mérite – celle-ci ne se cultive pas, ne s'entretient pas et ne se fertilise pas toute seule. Elle est tout simplement là. C'est la première racine de la gratitude.
Cette surabondance est au cœur des Psaumes 127 et 128, qui sont au centre de la série (120 à 134) dite "du pèlerin" : « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ; si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur : Dieu comble son bien-aimé quand il dort. » (Psaume 127, 1-2). Dans ces beaux et célèbres versets, le psalmiste affirme la priorité de la profusion de la grâce sur nos mérites. Cet incipit, cette succession de "en vain" qui rappelle tant le Qoelet (un livre que la Bible attribue, comme le Psaume 127, à Salomon) est l'une des plus belles explications de ce que sont la gratuité et la grâce. Pour comprendre cela, il faut continuer à lire la deuxième partie du Psaume 127 et ensuite enchaîner avec le Psaume 128 : « Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense qu'il accorde ; comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes ! » (127, 3-5).
Nous retrouvons ici le grand thème biblique de la bénédiction, développée dans le psaume suivant : « Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! A toi, le bonheur ! Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de la table, comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. » (128, 1-4). Le bonheur biblique, contrairement à la tradition moderne qui l'associe au plaisir et aux sensations, fait référence à la fécondité et à l’engendrement, également présents dans le latin felicitas (dont le préfixe fe rapproche des mots fœtus, femme, fertile).
Mais ces deux psaumes contiennent bien plus que cela. Il y a une idée théologique fondamentale dans la Bible, selon laquelle le bonheur, et donc les biens et les enfants, sont des bénédictions de Dieu. Cette équivalence entre le bonheur terrestre et la bénédiction divine est non seulement fondamentale et centrale dans l'éthique et l'esprit de l'économie moderne, mais elle est également au cœur du bon sens et de la sagesse des communautés et des familles - le Psaume 128 est le plus lu dans les liturgies juives et chrétiennes du mariage.
Mais c'est précisément dans cette splendide série de béatitudes que se cachent les pièges qui sont toujours au cœur de l'humanisme occidental. Trop souvent, en fait, nous avons lu et relu ces deux psaumes amputés des deux premiers versets du psaume 127, et ainsi tout le discours sur la bénédiction s’en trouve faussé et dévoyé. Dans la Bible, on peut parler des biens comme d'une bénédiction parce qu'ils sont précédés par la certitude morale qu'à un niveau beaucoup plus profond, les biens sont un don. Dire que ceux qui "construisent la maison" n’en sont pas les constructeurs mais que c’est le "le Seigneur", c'est reconnaître que même dans les réalités les plus concrètes et les plus quotidiennes, où il est évident que c'est nous qui, par notre travail, ajoutons, à un niveau plus profond et donc plus vrai, pierre sur pierre, celles-ci et notre sueur sont de l’ordre de la grâce, qu’elles sont providentielles.
Et nous devons reprendre ici un discours jamais conclu sur les mérites et la grâce. Lorsque nous voyons que, d’une manière ou d’une autre, une personne a réussi, , il est très rare de ne pas lui reconnaître une part de mérite personnel dans cette réussite . Ainsi, sans négliger le rôle de la chance et des circonstances favorables, nous prenons la part de mérite présente dans cette réussite et en faisons le socle sur lequel nous édifions l'ensemble de la structure sociale des récompenses. Ensuite, par souci de symétrie, nous suivons la même logique pour les échecs et les défaillances, car même si des circonstances malheureuses et défavorables se cachent derrière un crime ou un malheur, il s’y trouve aussi un certain pourcentage de culpabilité subjective. Nous l'isolons et en faisons le principal critère qui régit les sanctions et l’ordre social. Il n'est pas exclu que nos sociétés ressentent le besoin d'un système de blâmes pour légitimer les mérites, car dans un monde où l'on dit que le malheur dépend trop des circonstances malheureuses et trop peu de la culpabilité subjective, il n'y aurait même pas de base éthique pour attribuer nos succès à nos mérites.
Mais c'est précisément là que les deux premiers versets du psaume 127 prennent toute leur importance. Prenons le cas de John, ce collègue économiste particulièrement brillant. Il a fait carrière et connu le succès et la richesse. Issu d'une famille pauvre, il a dû beaucoup étudier pour obtenir son diplôme puis son doctorat. Ses parents ont fait des sacrifices pour lui permettre d’étudier, d'abord en Italie, puis aux États-Unis. Il a réussi de nombreux concours et s'est avéré être toujours le meilleur... Il est difficile de ne pas attribuer une bonne ou une grande partie de son succès à son mérite. Mais en y regardant de plus près, on découvre que même ce raisonnement, à première vue évident et peu discutable, peut s’avérer plus complexe et susceptible d’être reconsidéré : on se rend compte que Giovanni est né dans une famille qui l'aimait, puis qu’ il a étudié gratuitement pendant plus de vingt ans, qu’il a eu d'excellents professeurs qui ont cru en lui, qu’il a grandi dans un environnement serein et gratifiant. Et s'il a beaucoup étudié pour réussir des concours et écrire des articles scientifiques, sa capacité à étudier et à s'engager était aussi en grande partie un don qu’il a trouvé en lui comme le fruit de tout cette profusion de vie - on devient pauvre, entre autres, parce qu'on n'a pas la possibilité de s'engager.
Si John avait grandi ailleurs, ce même ADN n'aurait pas bénéficié des conditions lui permettant d’étudier et de réussir. Tout cela non pas pour diminuer, mépriser ou dévaloriser ses talents et sa vertu, mais pour souligner qu'il y a d'abord autre chose : la présence d’une surabondance qui a construit pour lui et avec lui sa "maison" et, encore en amont, ses talents.
Lorsque nous oublions ce bâtisseur invisible - et nous le faisons de plus en plus - les théologies, les sociologies et les économies de la prospérité naissent trop vite, et, tout en louant et légitimant les succès et les mérites sur le plan éthique et religieux, elles délégitiment religieusement les perdants, et finissent par considérer l’absence de talents comme une absence de mérites, au point de justifier moralement l'inégalité ; et pour pouvoir dire que ceux qui gagnent sont bénis, elles doivent dire qu’une malédiction pèse sur ceux qui ne réussissent pas.
Mais on ne peut pas s'arrêter là. Tout ce discours n’est pas satisfaisant. Ma petite-nièce Antoinette me l'a fait comprendre avec sa théologie basique lorsque nous avons dit la prière avant le repas : « Nous remercions Dieu pour la nourriture, mais comment les enfants qui n'ont pas de quoi manger prient-ils ? » Rendre grâce à Dieu et à la vie pour des bénédictions que nous avons sans mérite ne suffit pas à justifier Dieu aux yeux de ceux qui en sont dépourvus. Tout homme religieux qui attribue ses bénédictions à Dieu tend (presque) inévitablement à séparer Dieu de ceux de ceux qui vivent dans la misère. « Ma mère m’a envoyée me prostituer dès l'âge de huit ans : si je rencontre Dieu, j'ai envie de lui cracher au visage », a déclaré désespérément une jeune Brésilienne à un ami missionnaire. Si j'associe la grâce de Dieu aux dons que j’ai reçus, comment puis-je le délier du malheurs des autres ?
Un certain athéisme honnête est né parce qu'il ne trouvait pas de réponse convaincante à cette question, et a préféré tuer Dieu pour sauver les pauvres. Quelques autres ont réussi à garder la foi, mais ils ont lu ces psaumes assis aux côtés de Job, sur son tas de fumier, ou sur le mont Golgotha, au pied du Crucifié. Et puis un jour, qui arrive toujours trop tard, ils se sont rendu compte que leur véritable salut était d'avoir enfin compris qu’ils avaient reçu des richesses et des talents pour libérer ceux qui n'ont en héritage que souffrances et misères. Ils ont alors éprouvé un besoin irrésistible de descendre dans les rues et sous les arcades pour servir des petits-déjeuners, pour essayer de faire jaillir des cœurs quelques vrais « mercis » après trop d'imprécations. Et tandis qu’ils se donnaient sans réserve aux pauvres, ils leur disaient : vous n'êtes pas maudits. Il est urgent de le dire, de le répéter, sans jamais s’arrêter, jusqu'à donner sa vie.