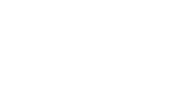Un homme nommé Job / 4 – Le juste peut le dire : aucun fils ne mérite de mourir
Par Luigino Bruni
Paru dans Avvenire le 05/04/2015

(Fedor Dostoïevski, "Le grand inquisiteur", Les frères Karamazov)
L’humanisme biblique n’assure pas le bonheur aux justes. Moïse, le plus grand des prophètes, meurt seul, en dehors de la terre promise. Il y a pour les justes quelque chose de plus vrai et plus profond que la recherche du propre bonheur. On demande beaucoup plus à la vie : surtout le sens de nos malheurs et de ceux des autres. Le livre de Job assiste celui qui cherche obstinément le vrai sens des grandes promesses déçues, du malheur des innocents, de la mort des filles et des fils, de la souffrance des enfants.
Après le dialogue initial avec Elifaz, c’est maintenant le second ami qui prend la parole : « Bildad de Chouha prit alors la parole : "Combien de temps nous tiendras-tu de tels discours ? Et quand s'arrêtera cet ouragan de mots ? Crois-tu vraiment que Dieu modifie la justice, ou que le Dieu très-grand fasse une entorse au droit ? Tes fils ont dû commettre une faute envers lui, et il leur en a fait payer les conséquences" » (8, 1-4). Pour ne pas mettre en discussion la justice de Dieu, Bildad est contraint de nier la droiture de Job et de ses fils. Son éthique est abstraite et froide : si les fils (et Job) ont été punis, c’est qu’ils avaient péché. Son idée de la justice divine et de l’ordre le pousse ainsi à condamner et à trahir l’homme. Ils sont au contraire nombreux les fils qui meurent sans aucune faute, aujourd’hui comme hier et toujours. Sur les Alpes françaises, au Kenya, sur le Golgotha. Partout. Aucun péché à expier n’exige la mort d’un fils, à moins de vouloir nier toute différence entre Elohim et Baal, entre YHWH et les idoles avides.
Le poème de Job est un test sur la justice de Dieu, pas sur celle de Job (qui nous est révélée dès le début du prologue). C’est à Elohim de prouver sa justice en dépit de la douleur des innocents. Deux possibilités s’offrent à Job pour répondre à son ‘ami’ : la première, toujours plus simple, est d’admettre qu’il n’y a aucune justice en ce monde : Dieu n’existe pas ou il est trop loin pour être le juste juge des hommes. La seconde est de tenter l’impensable pour un croyant en ce temps-là (comme en tout temps) : mettre en cause la justice de Dieu, lui demander de rendre compte de ses actes. Dans sa réponse à Bildad, Job traverse ces deux possibilités extrêmes : « Suis-je innocent ? Je ne me connais pas moi-même. Je suis dégoûté de la vie. Tout est pareil, et j’ose dire : Dieu fait périr aussi bien l’innocent que le coupable. Quand une catastrophe arrive tout à coup et tue des innocents, Dieu n'a que moqueries pour toutes leurs détresses ! Dans un pays livré au pouvoir d’un méchant… » (9, 21-24). Ce n’est pas sa vie qui intéresse Job (pure gratuité), mais la justice dans le monde ; aussi ose-t-il ce qu’on ne peut oser : nier que puisse exister une quelconque justice de Dieu.
Job continue ainsi d’élargir l’horizon de l’humain dans l’humanisme biblique, prenant dans son arche tous ceux qui, nombreux, ne cessent de se demander s’il existe un Dieu bon et juste dans un monde où la souffrance et le mal sont inexplicables. Job nous dit qu’une question sans réponse peut être plus ‘religieuse’ que des réponses trop simples, et qu’un ‘pourquoi’ peut aussi être prière. Après Job, il n’y a pas sur terre de chapelet plus vrai que celui de tous les ‘pourquoi’, désespérément sans réponse, qui s’élèvent vers un ciel qu’ils continuent de vouloir habité et ami.
Job continue de demander pour la terre un fondement plus profond que le chaos et le néant. Mais dans sa quête d’un Dieu vrai au-delà de l’apparente ‘banalité du bien’, Job, à la fois fort et fragile, demande à Dieu de répondre de ses actions, le veut responsable.
Il y aurait eu une voie plus simple, le raccourci que lui conseillent ses amis : admettre sa culpabilité. Mais Job est mystérieusement fidèle à lui-même et à la vie, et ne suit pas cette troisième option. Il aurait pu se reconnaître pécheur (quel homme juste n’a pas conscience de l’être ?), implorer le pardon et la miséricorde divine, sauver ainsi la justice de Dieu, et même espérer son propre rachat. Il ne le fit pas, continua de demander des explications, de dialoguer, d’attendre que Dieu se montre à lui différent ; de croire en sa propre droiture.
Il est difficile pour une personne juste, dans les longues et exténuantes épreuves de la vie, de ne pas perdre foi en sa propre vérité et justice, finissant par dire : "Il n’est pas vrai que je l’ai fait pour le bien…", "J’ai été orgueilleux…", "Au fond j’ai tout bluffé…". Mais quand nos fautes (nous en avons toujours) nous entraînent ainsi dans une lecture déformée de notre vie, la vérité nous échappe et nous nous perdons. C’est un autre désespoir, moins vrai, qui nous pousse alors à implorer le pardon et la miséricorde de Dieu et des autres.
Ce fléchissement n’est pas humilité : il n’est que la dernière grande tentation. Nous ne serons sauvés d’épreuves semblables à celles de Job que si l’histoire de notre innocence et de notre droiture nous convainc davantage que celle de nos péchés et de notre méchanceté. C’est la foi et la fidélité à cette chose - ‘cela était très bon’ (Gn 1, 31) - que malgré tout nous sommes et restons, qui peut nous sauver dans les rudes et longues épreuves. C’est à sa (et notre) dignité que s’accroche Job : "Souviens-toi : tu m’as fait comme on pétrit l’argile" (10, 9). Une foi qui englobe aussi les fils, les personnes qu’on aime, capable un jour d’inclure tout être humain. Job a continué de croire en son innocence afin que nous, moins justes que lui, puissions aujourd’hui continuer de croire en la nôtre.
Et puis Job ne peut pas croire que ses fils aient mérité la mort. Aucun fils ne mérite de mourir. Il y a sur terre grande vérité et beauté grâce aux mères et aux pères qui ne cessent de croire, parfois contre toute évidence, à l’innocence des fils et des filles. Il a souvent suffi, pour que nous soyons sauvés, qu’une seule personne croie davantage en notre beauté et notre bonté qu’en nos erreurs. Combien plus triste serait la terre sans ces regards ressuscités des mères et des pères !
L’extrême fidélité de Job à lui-même le pousse ensuite à l’acte le plus subversif. Il ne veut pas nier la justice de Dieu, mais ne peut pas non plus nier sa propre vérité. Alors, de l’étau dans lequel il semble pris, voici surgir une surprenante troisième possibilité. Job appelle en justice Dieu lui-même. Son tas de fumier se transforme en tribunal. L’accusé est Elohim, ses avocats sont les amis de Job, et Job est l’interrogateur. « Puisque la vie m’est en dégoût, je veux donner libre cours à ma plainte, je veux parler dans l’amertume de mon âme. Je dirai à Dieu : "Ne me condamne pas, indique-moi pourquoi tu me prends à partie. Est-ce bien, pour toi, de me faire violence, de rejeter l’œuvre de tes mains et de favoriser les desseins des méchants ?" » (10, 1-4).
Mais comment peut-on appeler Dieu en justice, le dénoncer, si l’accusé est aussi le juge ? « Car lui n’est pas, comme moi, un homme : impossible de lui répondre, de comparaître ensemble en justice. Pas d’arbitre entre nous pour poser la main sur nous deux » (9, 32-33).
En réalité, il y a bien un juge-arbitre dans tout le livre de Job : le lecteur, qui, durant le développement du drame, est appelé à prendre parti, à se dire pour l’un ou pour l’autre des adversaires. Un lecteur-arbitre contemporain de Job l’aurait condamné, prenant sa harangue pour de l’orgueil, de la nonchalance. Mais la défense de Job s’est développée avec l’histoire, avec les prophètes, les évangiles, Paul, les martyrs, et puis la modernité, les camps de concentration, le terrorisme, l’euthanasie des enfants. Job nous est plus contemporain qu’à l’homme de son temps, et il le sera plus encore dans les siècles à venir.
Ce ‘procès à Dieu’ nous introduit dans une authentique révolution religieuse : Dieu aussi doit rendre compte de ses actions s’il veut être le fondement de notre justice. Il doit se faire comprendre, ajouter d’autres paroles aux si nombreuses qu’il a déjà dites, pour être à la hauteur du Dieu biblique de l’Alliance et de la Promesse, et nous affranchir des cultes idolâtres, aussi stupides que leurs fétiches. Ainsi donc, le Dieu de Job, enchâssé au cœur de la Bible, nous porte sur une haute cime et nous invite, de là, à regarder toute la Torah, les prophètes, et puis le Nouveau Testament, les femmes et les hommes de tout temps. Il nous donne la preuve de la véracité des livres qui le précèdent et de ceux qui le suivent.
Un autre procès eut cours, avec Dieu comme accusé. Mais les parties furent renversées. L’homme était le fort, quasi tout-puissant, qui interrogeait et jugeait. Dieu était fragile ; il fut condamné, crucifié. Entre ces deux procès extrêmes se situent toute la justice, l’injustice, les espoirs du monde. Cela, Job ne le savait pas, ne pouvait pas le savoir. Mais il aura été le premier à fêter le sépulcre vide. Seuls les crucifiés peuvent comprendre et désirer les résurrections. Bonne fête de Pâques !