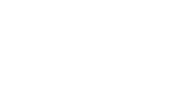La foire et le temple/18 - Le clôture monastique visait à protéger les femmes mais aussi à empêcher l'ingérence masculine.
par Luigino Bruni
Publié dans Avvenire le 07/03/2021
Entre le Moyen-Âge et la modernité, la vie sociale et économique des monastères féminins s'est enrichie de la bénédiction de l’ "ora et labora", de péchés collectifs et de "joyeuses" désobéissances.
« En 1602 à Rome, il y eut un procès après la découverte d'un trou percé dans la pièce des épices d'où l'on pouvait voir la rue. Il est apparu que la seule coupable était une jeune converse, Sœur Damiana, qui a admis avoir pratiqué cette ouverture avec la grande broche utilisée pour la cuisson des rôtis . Interrogée sur ses raisons, elle a répondu que ce n'était "rien d'autre pour voir les gravats sur le côté, qui se détachaient, j'avais envie de voir d'où ils venaient. » (Alessia Lirosi, Les monastères féminins à Rome à l’époque de la Contre-réforme, Viella 2012).
La vie sociale et économique des monastères de femmes entre le Moyen Âge et la modernité constitue une immense richesse. Dans ces clôtures collectives, presque toujours forcées, se sont déroulés des processus humains qui sont aujourd'hui presque entièrement oubliés, même par le mouvement des femmes et des féministes. En ce 8 mars, mon premier souhait s’adresse à ces religieuses, et à leurs sœurs d'aujourd'hui.
Les monastères féminins ont toujours été des institutions où la liberté était restreinte et contrôlée par des hommes. Des hommes, presque toujours célibataires, qui à partir de l’archétype féminin de leur imagination, ont édicté des règles pour régir la vie de femmes en chair et en os : « Le vœu de chasteté étant tel, les religieuses y sont d'autant plus tenues en raison de la fragilité de leur sexe. » Et pour protéger le sexe fragile qui, selon ces théologiens, les exposait plus facilement (que les hommes !) au péché de chair, « la supérieure doit veiller à ce que les barreaux en fer des grilles des parloirs soient suffisamment ressérés pour qu’on ne puisse y passer la main. » (Giovanni Pietro Barco, Specchio religioso per le monache, 1583). Aussi la clôture ne visait-elle pas seulement à "enfermer des femmes" mais aussi, comme le rappelle mon amie carmélite Antonella, à "éloigner" les hommes du monastère et empêcher leur ingérence, même sans jamais y parvenir complètement.
Les monastères de femmes ont également vécu à leur manière la maxime ora et labora : parallèlement et à côté du travail de copiste (qu’on ne met pas encore assez en valeur), ils ont vu naître de véritables écoles de broderie (selon l'école italienne qui laisse à découvert le bas du tissu). Un autre secteur "habituel" était celui de la confection de gâteaux (et aussi de liqueurs) : « La ville de Bologne fait un commerce notable de confitures ou de gelées de coing. Les religieuses rivalisent dans la confection de ces douceurs. » (Jean-Baptiste Labat, Diario, 1706). Dans toute la Sicile, des religieuses se sont spécialisées dans la fabrication de gâteaux et de friandises. Les recueils des recettes les plus rares étaient considérés comme une sorte de monopole secret des monastères féminins - la "frutta martorana" vient du monastère féminin de la Martorana. Toujours en Sicile (Noto), le travail de la cire dans les monastères de femmes était réputé et d’un niveau remarquable. On y produisait également du vinaigre, des parfums, on y cultivait des fleurs, on y fabriquait des roses en soie, des savons, mais aussi des cilices, des fouets, des chaînes, des bracelets et colliers pour filles (Antonino Terzo di Palazzolo et Lina Lupica, Les travaux des Moniales, 1991).
Leur travail artistique était important et peu connu. En plus de jouer de divers instruments et d'être respectées et recherchées comme professeurs de chant, les soeurs écrivaient des poèmes et des pièces de théâtre qui étaient mis en scène à l’occasion des célébrations religieuses (Elissa B. Weaver, théâtre dans les couvents italiens au début de l’époque moderne). Après le Concile de Trente, les abbesses ont opposé une forte résistance aux évêques qui essayaient d'imposer des restrictions en matière de théâtre, de musique et de chant dans les monastères : « Qu'aucune comédie ni représentation n’ait lieu. » (in Angela Fiore, la tradition musicale du monastère des clarisses de Sainte Claire à Naples). Ces interdictions sont presque toujours ignorées. Il est intéressant de noter la figure de Soeur Plautilla Nelli (1524-1588), mentionnée par Vasari : il note que les saints de Soeur Plautilla étaient très "féminins" : « Sœur Plautilla Nelli remplaçait Cristi par Criste" (Vincenzo Fortunato Marchese, Memorie dei più insigni pittori...).
En consultant les archives, et en particulier des livres de chroniques rédigés par les moniales elles-mêmes, il est évident et manifeste que ces monastères reflètent les structures sociales et les hiérarchies qui les avaient engendrés : riches et pauvres, patriciens et plébéiens, hommes et femmes. Les religieuses étaient divisées en choristes (ou voilées) et converses (ou servantes), parfois appelées "dames" et "servantes" (Clarisse de Naples). Les choristes, qui priaient dans le chœur et avaient fait profession solennelle, étaient les religieuses de plein droit. Elles élisent l'abbesse, qui doit nécessairement être choisie parmi elles, et peuvent être des "fonctionnaires", c'est-à-dire occuper les fonctions liées à la gouvernance des monastères - apothicaire, maîtresse de chœur, maîtresse des novices, portier, vicaire, chambellan, sacristain, trésorier, cellérier -, et elles seules peuvent faire partie du conseil des abbesses (les moniales "discrètes"). Les sœurs converses étaient souvent analphabètes, socialement inférieures et traitées comme telles, elles dormaient dans des dortoirs, devaient s'occuper des tâches ménagères, des sœurs malades et des travaux les plus subalternes du monastère. Elles dispensent ainsi les sœurs voilées des tâches ingrates. Et si une religieuse savait lire, elle devait s'en abstenir pour conserver ses distances avec les choristes "de haut rang".
Après le Concile de Trente, les converses ont été transférées dans un bâtiment séparé, bien qu'elles aient continué à être les servantes personnelles de chaque choriste. À San Silvestro in Capite (Rome), en 1665, les choristes se plaignaient que les converses de l'infirmerie ne voulaient pas accomplir les tâches les plus humbles, et qu'elles ne cédaient pas leur place au parloir. Le mépris de la société pour les soins infirmiers, qui marque encore notre civilisation, ne dépend pas seulement de leur caractère féminin et donc domestique ; il résulte également de la hiérarchie sociale entre les femmes. Les femmes nobles l'étaient aussi parce qu'elles n'étaient pas préposées aux soins infirmiers, grâce à d'autres femmes pauvres (hier dans les monastères et les palais patriciens, aujourd'hui dans nos maisons). Et pourtant, au sein de ces paradoxes qui aujourd'hui nous sont incompréhensibles si nous ne faisons pas un effort considérable d'empathie historique, quelque chose de nouveau était en train de naître.
Un premier domaine, aussi problématique que paradoxal, est celui du droit pénal. La conception de la peine, comprise comme rééducation et réhabilitation, est attribuée au mouvement des Lumières et à l'utilitarisme du XVIIIe siècle (Beccaria et Bentham). Le rôle des monastères est rarement mentionné. C'est également pour punir les moines et les nonnes que la peine a évolué sous la forme d'un emprisonnement durable dans une prison du monastère, absent dans le monde antique. Par exemple, dans le monastère augustinien de Santa Marta à Rome, la religieuse qui avait commis une faute très grave « était séquestrée, avec discrétion et charité, toujours à condition qu'elle se convertisse et fasse pénitence". La prison avait pour objectif le rachat des coupables, ce qui se rapproche de la vision moderne de la punition. Le champ lexical de l’univers carcéral ne va pas sans rappeler celui des monastères : "cellules" et "parloir".
La vie économique des monastères de femmes est une mine presque entièrement inexplorée. Tout d'abord, un étonnement (du moins le mien) : celui de la résistance des religieuses à la "communion des biens", que le Concile de Trente a tenté de réintroduire. À la lecture des documents, on constate que, malgré les visites et les directives des évêques, les monastères féminins ont désobéi au sujet de la propriété privée des religieuses. Pourquoi ?
Significatif également l’épisode rapporté dans l'ouvrage fondamental d'Alessia Lirosi sur les monastères romains. En 1601, le cardinal protecteur demanda l'abolition de la propriété privée personnelle : « Lorsque le cardinal eut fini son discours, d'un commun accord, toutes les Abbesses répondirent qu'elles avaient eu dans le passé le même désir ; mais que le monastère n'avait pas la faculté de maintenir ces biens en commun, de sorte que les moniales furent obligées de reprendre chacune leurs biens. » Elles ont donc essayé, dit l'abbesse, mais la gestion commune n'a pas fonctionné. Le cardinal a insisté, aussi les religieuses « sans faire d'autre réponse, avec une joie indicible, ont apporté dans la pièce du crucifix des draps de lin et de laine, et tout ce qu’elles avaient comme biens personnels.» Mais, ajoute A. Lirosi, « après ce brutal tour de vis, quelque chose s'est lentement relâché. En fait, quelques années plus tard, en 1607, les dispositions données par le cardinal ont été réitérées, interdisant à nouveau les broderies et les soieries sur les nappes de l'autel de chacune ou sur leurs rideaux. » Les abbesses et leurs moniales ont donc résisté à l'ordre de la communion des biens. Cette désobéissance était-elle l'expression d'un attachement à leurs biens de la part de ces riches femmes nobles ? Ce fut parfois le cas, peut-être presque toujours. Mais je pense que certaines abbesses ont désobéi pour quelque chose de beaucoup plus important. Et dans ces quelques religieuses différentes, ne serait-ce qu'une seule, se trouvaient toutes les femmes du monde.
Lorsque la vie nous conduit dans un enfermement, et qu'un jour nous nous approchons de la grande broche pour faire un trou dans le mur afin de voir la vie s'écouler au-delà de notre enceinte, nous découvrons soudain la valeur des choses. Elles s'illuminent autant, sinon davantage, que l'autel et les statues de la chapelle. Elles nous parlent, elles nous disent qu’on existe vraiment, qu’on est bien là. Et l’on comprend que le fait d’être obligé de sortir nos affaires de notre coffre, "les broderies et les soies des nappes du petit autel", de renoncer à ces petits riens qui nous permettent de dire c’est à moi ("Que personne ne consière une chose comme sienne, mais puisse dire de toutes qu’elles sont les nôtres et retienne comme mal de dire : c’est à moi ", Constitution monastique citée citée par Lirosi) est une violence excessive, à laquelle les moniales et leurs abbesses ont résisté (une belle solidarité entre femmes, du moins dans ce cas), en raison de cet instinct vital propre aux femmes. Il y a une réalité proprement féminine et différente que nous n'avons pas encore comprise.
Le sens véritable et juste de la propriété privée n'est peut-être pas né uniquement dans les traités de Locke ou de Duns Scot ; quelques lignes ont même été écrites à l'intérieur de ces cloîtres, lorsque certaines femmes ont refusé de dire c’est à nous parce qu'elles avaient le sentiment que ce nous les tuait purement et simplement. Cela nous rappelle que tous les "notres" ne sont pas bons, mais seulement ceux qui sont nés des rencontres gratuites entre de nombreux "miens" offerts. Hier et aujourd'hui. La bonne communion des biens est le point d'arrivée du voyage, c'est l'aboutissement d'un processus de communion de vie qui s'épanouit un jour en une communion de biens, jamais imposée ni demandée d'office comme le paiement dû aujourd'hui pour un chèque en blanc signé hier. La "mine" qui ressuscite en "nôtre" ne peut être que le fruit de mon choix qui devient aussi le vôtre. A l'extérieur et à l'intérieur des monastères. Trop de "nôtres" ne sont au contraire que des couvertures idéologiques d'abus de pouvoir et de violence. Tout comme il existe une propriété privée née du péché individuel - a rappelé Duns Scot - il existe aussi une propriété commune qui naît du péché collectif.
Le trou que Soeur Damiana perce dans le mur, le refus répété de la destruction des oeuvres théâtrales, la désobéissance des abbesses aux cardinaux faite avec "jubilation", doivent être comptés parmi les actes de liberté qui ont engendré l'esprit de ma modernité, celui des hommes et des femmes. Mais aujourd’hui notre société laïque l’ignore.