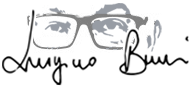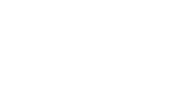Éditorial – Le remède quotidien contre la guerre
par Luigino Bruni
publié dans Avvenire le 25/09/2025
Il y a quelques jours, une de mes amies avait des difficultés à payer une amende par voie électronique. Elle s'est adressée à une employée de la police qui l'a écoutée et a résolu son problème. En la remerciant, mon amie lui a dit : « Ce serait formidable si tout le monde travaillait comme vous ! », et cette policière s’est émue. Son émotion m'a touché et m'a beaucoup éclairé.
Chaque jour, nous sommes plongés dans un océan de réciprocité, sans même nous en rendre compte. Un réseau très dense d'amour social entre des inconnus qui nous préparent le petit-déjeuner, nous soignent dans les hôpitaux, éduquent nos enfants à l'école, produisent les objets que nous utilisons, nettoient nos rues et s'occupent de nos aînés. C'est aussi un visage du marché, ou plutôt : le marché est avant tout cet immense réseau de coopération, le plus grand et le plus vaste jamais réalisé au cours de l'histoire humaine. Et le ciment qui maintient cet admirable édifice éthique est le travail, le travail humble et quotidien : nous nous rencontrons, nous nous servons, nous nous parlons simplement en travaillant. Quand on voit ce qui se passe chaque jour grâce au travail des infirmières, des médecins, des enseignants, des maçons, des conducteurs de tramway, des éboueurs, des serveurs, on en vient à douter fortement que la fraternité soit vraiment le « principe oublié » de la Révolution française, ou si, au contraire, ce n'est pas ce que nous avons le plus développé collectivement : ce n'est certainement ni l'égalité ni la liberté qui font fonctionner, chaque matin, les hôpitaux et les écoles. Sans l'école et la santé publique, la liberté et l'égalité effectives seraient trop faibles, mais ce qui nous pousse à agir à chaque instant dans une classe ou dans un service d'urgence se traduit plus facilement par le mot fraternité ; car la fraternité est un lien, une relation, ce n'est ni un droit ni un statut individuel – c'est le bien qui se tisse entre les personnes, qui les relie. Et si un jour les ordinateurs et l'IA font le travail que nous faisons aujourd'hui, nous devrons vite réinventer un autre langage tout aussi sérieux pour communiquer entre nous et ne pas sombrer dans un cauchemar où chacun ne rencontre que lui-même.
Mais il y a autre chose à dire. Les bonnes façons de coopérer coexistent avec les mauvaises. Car si la plupart des femmes et des hommes coopèrent pour faire vivre d'autres femmes et d'autres hommes, il y en a d'autres, une petite minorité, qui s’associent pour faire mourir, moralement et physiquement, d'autres femmes, d'autres hommes et d'autres enfants. Ce sont des personnes qui vivent des jeux d'argent, de la pornographie et de la prostitution : des réseaux mafieux importants et de plus en plus mondialisés où l'on coopère différemment.
Le livre de la Genèse nous raconte d'abord la construction de l'arche de Noé (chap. 6), puis (chap. 11) celle de la tour de Babel. Les constructeurs de l'arche et ceux de la tour-forteresse étaient des travailleurs solidaires entre eux, car sans solidarité au travail, aucun ouvrage ne peut être entrepris.
Même dans la construction de la tour de Babel, il y a une action collective explicite, une communauté de travail. La comparaison entre l'arche de Noé et la tour de Babel nous montre que les solidarités et les associations ne sont pas toutes bonnes, que les initiatives ne contribuent pas au bien : le travail des maçons et des ingénieurs de Babel ne fut pas béni par Dieu qui les a dispersés. Il en va ainsi de certaines réalisations humaines qu'il est bon de défaire. C’est l’œuvre d'hommes et de femmes, qui, pris individuellement, sont souvent bons. La condamnation de Babel ne s'adresse pas au travailleur individuel, c'est une condamnation éthique de ces structures de péché, même lorsqu'elles résultent d’un travail et d’une coopération.
Le travail au service d’œuvres maléfiques coexiste chaque jour avec celui qui contribue au bien. Ces dernières années, nous prenons conscience de manière nouvelle et dramatique de la plus grande coopération maléfique dont les hommes sont capables : la guerre. La guerre est elle aussi une action collective, une coopération, un travail, un jeu d’alliances très complexe. Aucune bataille ne peut être gagnée sans une coopération parfaite, aussi bien dans les usines d'armes que sur les champs de bataille. Mais, si nous y regardons de plus près, nous nous rendons compte que la coopération guerrière diffère radicalement de nos échanges quotidiens. Il s'agit de celle d'un groupe contre celle d'un autre. C'est un jeu à somme nulle (+1,-1) ou à somme négative (-1,2), où la victoire d'un camp correspond à la défaite de l'autre.
C'est le contraire qui se passe dans nos échanges de la vie courante : le marchand de pizza qui me prépare une focaccia, et moi qui la savoure, nous partageons la même joie, qui se traduit par un salut final : « merci », « merci à vous », une réciprocité partagée et affectée du même signe positif (+1,+1).
En tant que citoyens ordinaires, nous ne pouvons pas faire grand-chose face à l'absurdité de ces nouveaux vents de guerre. Il en résulte un grésillement moral constant, qui réduit notre bonheur, et tant mieux s’il en est ainsi, car un bonheur sans ombre serait totalement déplacé aujourd'hui, au milieu de toute les douleurs de notre monde. Chaque matin, des milliards de personnes disent non à la guerre en disant oui à leur travail, aux bons échanges de services, à la bienveillance contagieuse d’une réciprocité partagée. Nous pouvons vivre notre travail comme un remède contre la guerre, en regardant dans les yeux les personnes qui travaillent avec nous et pour nous, et peut-être commencer à les remercier plus souvent : leur émotion peut raviver notre espérance.